Suite du billet précédent : Les didactiques et les visionnaires
Poésie et révolutions scientifiques
Le début du XXe siècle, loin de marquer le déclin de la poésie scientifique au sens le plus large du terme, a au contraire réuni toutes les conditions propices à un formidable renouvellement du genre. La démonstration est simple. Tout le monde s’accordera sur le fait que les représentations scientifiques du cosmos évoluent au cours des siècles par bonds successifs, au gré de ce que l’on appelle des « révolutions scientifiques » entre lesquelles s’établissent des paradigmes provisoires.
L’histoire des sciences de l’univers a connu essentiellement quatre révolutions scientifiques. La première remonte à la Grèce antique, lorsque avec Thalès, Anaximandre, Démocrite, Anaxagore, suivis de Pythagore, Platon et Aristote, le discours logique sur l’univers remplace progressivement le discours mythique.
La seconde révolution est l’avènement de l’héliocentrisme au XVIeet au début du XVIIe siècle, lorsque Copernic, Kepler et Galilée établissent la position centrale du Soleil dans l’Univers connu et, par là même, contribuent à minimiser l’importance des affaires terrestres ou humaines.
La troisième révolution date des Principia de Newton publiés en 1687, dans lesquels le savant anglais affirme l’infinité de l’univers et fournit un cadre physico-mathématique pour décrire le mouvement des corps célestes : c’est la fameuse loi d’attraction universelle.
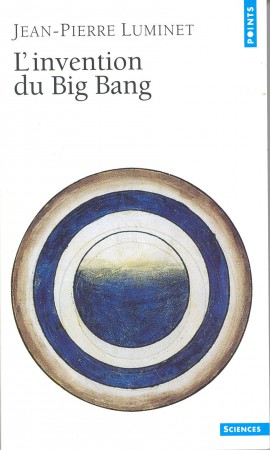 La quatrième révolution date des trois premières décennies du XXe siècle, avec la théorie de la relativité et de l’espace-temps courbe d’Albert Einstein, les modèles de big-bang de Georges Lemaître qui en découlent, et la naissance de la mécanique quantique pour décrire l’infiniment petit. À noter, et là je parle en tant que physicien théoricien, qu’une cinquième révolution est probablement en cours, bien que nous n’ayons pas encore le recul suffisant pour en juger, avec les tentatives actuelles de trouver une théorie unifiée de toute la physique, qui s’appellent théorie des cordes, modèles branaires ou gravitation quantique à boucles.
La quatrième révolution date des trois premières décennies du XXe siècle, avec la théorie de la relativité et de l’espace-temps courbe d’Albert Einstein, les modèles de big-bang de Georges Lemaître qui en découlent, et la naissance de la mécanique quantique pour décrire l’infiniment petit. À noter, et là je parle en tant que physicien théoricien, qu’une cinquième révolution est probablement en cours, bien que nous n’ayons pas encore le recul suffisant pour en juger, avec les tentatives actuelles de trouver une théorie unifiée de toute la physique, qui s’appellent théorie des cordes, modèles branaires ou gravitation quantique à boucles.
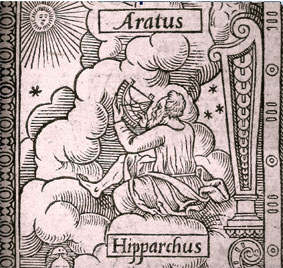
Maintenant, il ne vous échappera pas que les trois périodes dites « de gloire » de la poésie scientifique que j’ai mentionnées au début, à savoir l’Antiquité gréco-latine de Lucrèce, Aratus ou Manilius, le XVIe siècle de la Pléiade et le XVIIIe siècle de Delille, Young ou Chénier accompagnent ou suivent précisément les changements de paradigme cosmologique ; il est évident que chaque révolution scientifique engendre une abondante production poétique, signe par ailleurs que le ciel, même mathématisé et géométrisé, n’en garde pas moins une part de son attrait poétique.
Dès lors, comment imaginer que la révolution relativiste et quantique soit la seule à être restée sans aucun effet sur l’imaginaire des écrivains et des poètes, et comment faire le constat de la mort de la poésie scientifique au moment même où toutes les conditions étaient réunies pour qu’elle connaisse une nouvelle impulsion ?
Déjà, en 1866, dans une lettre à Villiers de l’Isle Adam, Stéphane Mallarmé anticipe ce renouveau et décrit son propre programme poétique de la façon suivante : « J’avais, à la faveur d’une grande sensibilité, compris la corrélation intime de la Poésie avec l’Univers, et pour qu’elle fût pure, conçu le dessein de la sortir du Rêve et du Hasard et de la juxtaposer à la conception de l’Univers. ».

Je ne résiste pas à la tentation de vous citer l’un de ses poèmes daté de 1883 :
Quand l’ombre menaça de la fatale loi
Tel vieux Rêve, désir et mal de mes vertèbres,
Affligé de périr sous les plafonds funèbres
Il a ployé son aile indubitable en moi.
Luxe, ô salle d’ébène où, pour séduire un roi
Se tordent dans leur mort des guirlandes célèbres,
Vous n’êtes qu’un orgueil menti par les ténèbres
Aux yeux du solitaire ébloui de sa foi.
Oui, je sais qu’au lointain de cette nuit, la Terre
Jette d’un grand éclat l’insolite mystère,
Sous les siècles hideux qui l’obscurcissent moins.
L’espace à soi pareil qu’il s’accroisse ou se nie
Roule dans cet ennui des feux vils pour témoins
Que s’est d’un astre en fête allumé le génie.[3]
Ce poème est, de par la volonté délibérée de son auteur, susceptible de plusieurs interprétations. L’une d’elles relève d’une vision cosmique, tout au moins dans la dernière strophe, qui pourrait anticiper de cinquante ans la cosmologie relativiste. « L’espace à soi pareil » : depuis son origine, l’espace est homogène; « qu’il s’accroisse » : le chanoine Lemaître a démontré en 1931 l’expansion de l’univers à partir du big-bang. « Ou se nie » peut renvoyer à l’idée du big-crunch ou des trous noirs, c’est-à-dire l’effondrement gravitationnel et la disparition de toute chose dans une singularité. « Roule des feux vils pour témoins » évoque irrésistiblement la fuite générale des galaxies, dont le décalage spectral vers le rouge sert de témoin de l’expansion de l’univers. Et ainsi de suite. Bien entendu ceci n’est qu’un jeu d’interprétations a posteriori, mais qui illustre selon moi quelque chose que j’ai dit précédemment, à savoir comment un « rêveur d’univers » peut se forger un modèle mental personnel du monde qui rejoint, voire anticipe les découvertes des scientifiques. Des exemples analogues peuvent être trouvés dans l’Eurêka d’Edgar Poe, Les Chimères de Gérard de Nerval ou les Poèmes barbares de Leconte de Lisle.
L’univers relativiste et quantique a donc indubitablement influencé les poètes tout autant que les révolutions copernicienne et newtonienne, même si le temps de « digestion » de théories aussi complexes par le poète – forcément profane en science – peut s’avérer plus long.
Les exemples d’écrivains et poètes en résonance avec le paradigme relativiste et quantique sont innombrables : Marinetti, l’auteur du Manifeste du Futurisme qui, dans « Les licous du temps et de l’espace » de 1912, reprend à sa manière les concepts relativistes d’élasticité des distances et des durées ; Supervielle et ses Gravitations de 1925 ; Maeterlinck et sa Grande Féerie de 1929 ; Paul Valéry dans pratiquement toutes ses œuvres ; Henri Michaux qui, dans Le dépouillement par l’espace (1966), décrit comment l’espace du dedans renferme autant de gouffres et de lumières lointaines que l’espace galactique, et comment s’y perdre en dérives infinies.

Vous me rétorquerez peut-être qu’il ne s’agit plus là de poésie scientifique à proprement parler. Laissez-moi alors citer Charles Dobzynski, un poète qui a su intégrer avec un immense talent et beaucoup de pertinence les découvertes astrophysiques du XXe siècle. « La dernière galaxie » est un poème extrait d’un recueil plus vaste intitulé L’Opéra de l’Espace, publié chez Gallimard en 1963 et sur lequel je reviendrai plus loin. Dobzynski décrit dans un lyrisme puissant et avec une grande justesse scientifique comment la fuite générale des galaxies et le rougissement de leur spectre traduisent la réalité observationnelle de l’expansion cosmique :
La galaxie en fuite, goutte folle,
trop-plein de feu dont le vide déborde,
tombe parfois dans un autre univers.
Ivre de sa vitesse elle dévide
tout l’écheveau de la lumière et casse
l’ultime fil qui la retient à nous.
Elle franchit, dans le spectre visible,
la limite du rouge; elle se noue
pour mieux bondir dans la dimension
qui s’ouvre au-delà de la connaissance.
Un seul déclic d’espace, un clapotis
de clarté diffuse au large des âges
marque sa mort et sa métamorphose.
La galaxie en fuite à la fraieson
est une truite arc-en-ciel qui remonte
le cours du temps vers de plus basses eaux,
vers des retraits obscurs de la durée.
Le frai commence et c’est un flamboiement
d’astres couvrant l’ombre de leurs écailles.
Et le temps tombe ainsi qu’une laitance.
Ayant peuplé le vide d’alevins
et d’un levain d’aurores inouïes
la galaxie revient à son rivage,
mais à jamais son rivage la fuit.
Errant dès lors en un pays mental
– le no man’s land de l’être et du non-être –
la galaxie en exil sur un plan
plus secret de l’ombre et de la lumière,
nous traverse peut-être avec ses feux,
ses soleils fous et ses vrilles de vie,
abandonnant parfois dans nos sillons
à son passage un grain de sa mémoire.[4]

Références
[3] Dans Les Poésies de Stéphane Mallarmé, Edmond Deman, Bruxelles, 1899.
[4] Charles Dobzynski, « La dernière galaxie », L’Opéra de l’espace, Gallimard, Paris, 1963.
suite à venir : De Ponge à Queneau

Je voulais te dire simplement que j’avais lu ton texte et que je l’avais fortement apprécié ! Tu réponds à ce qui m’obsède depuis longtemps : comment nos visions du monde influencent nos imaginaires. Et là tu donnes une magnifique réponse. Merci merci. Je t’embrasse fort. MOM