Charles Dobzynski, écrivain et poète français d’origine polonaise, nous a quittés il y a un an, le 26 septembre 2014. Ayant eu le privilège de le connaître, je lui rends ici un bref hommage.

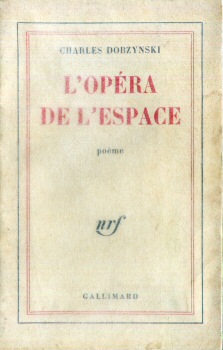 Ma première rencontre avec son œuvre remonte à 1995. Je préparais alors une vaste anthologie de textes poétiques inspirés par le cosmos[1], et au cours de mes recherches bibliographiques j’étais tombé sur son extraordinaire recueil L’Opéra de l’Espace, publié en 1963 aux éditions Gallimard. J’avais été fasciné de voir comment un poète, de formation essentiellement littéraire, avait su intégrer avec autant de talent et de pertinence les découvertes astrophysiques du XXe siècle.
Ma première rencontre avec son œuvre remonte à 1995. Je préparais alors une vaste anthologie de textes poétiques inspirés par le cosmos[1], et au cours de mes recherches bibliographiques j’étais tombé sur son extraordinaire recueil L’Opéra de l’Espace, publié en 1963 aux éditions Gallimard. J’avais été fasciné de voir comment un poète, de formation essentiellement littéraire, avait su intégrer avec autant de talent et de pertinence les découvertes astrophysiques du XXe siècle.
J’ai ensuite rencontré Charles Dobzynski en personne en 1998 aux Biennales Internationales de Poésie de Liège. Leur regretté fondateur, Arthur Haulot, m’avait invité à donner la conférence d’ouverture, que j’avais intitulée « L’univers, conquête ou servitude ». Le matin, au petit déjeuner de l’hôtel où tous les invités étaient logés, j’avais été très ému de voir soudainement arriver Charles Dobzynski, en compagnie de son épouse. Je m’étais présenté à lui, et le contact humain s’était aussitôt établi. Certes, Charles avait lu mon anthologie et apprécié les louanges que j’avais accordées à son Opéra de l’Espace ; mais surtout, il était resté authentiquement passionné par tout ce qui avait trait aux sciences de l’univers. Et c’est avec une sorte de gourmandise d’enfant qu’entre croissant et café, il m’avait bombardé de mille et une questions, toutes fort pertinentes, sur les trous noirs, le big bang et autres mystères du cosmos.
 Après cette heureuse rencontre, nous sommes toujours restés en contact assez étroit, à travers notamment de nombreux échanges épistolaires. Dans l’un d’entre eux, il me rappelait d’ailleurs qu’à ses débuts de journaliste, il avait lui-même été appelé à rédiger des essais de vulgarisation scientifique – ce qui expliquait en bonne partie son étonnante compréhension des développements de l’astrophysique contemporaine. Pendant de longues années nous avons aussi échangé nos publications dédicacées, et Charles faisait régulièrement l’éloge de mes ouvrages dans la rubrique de la défunte revue « Aujourd’hui Poème », qu’il tenait.
Après cette heureuse rencontre, nous sommes toujours restés en contact assez étroit, à travers notamment de nombreux échanges épistolaires. Dans l’un d’entre eux, il me rappelait d’ailleurs qu’à ses débuts de journaliste, il avait lui-même été appelé à rédiger des essais de vulgarisation scientifique – ce qui expliquait en bonne partie son étonnante compréhension des développements de l’astrophysique contemporaine. Pendant de longues années nous avons aussi échangé nos publications dédicacées, et Charles faisait régulièrement l’éloge de mes ouvrages dans la rubrique de la défunte revue « Aujourd’hui Poème », qu’il tenait.
Pour moi, Charles Dobzynski incarne, aux côtés de Jacques Réda, Maurice Couquiaud et quelques rares autres poètes, le renouveau que la « poésie scientifique » a connu au cours des cinquante dernières années. Ce genre littéraire très particulier a toujours été florissant et vivace, tout en connaissant des périodes de gloire, comme l’Antiquité grecque et latine, le XVIe siècle ou le siècle des Lumières, et des périodes de relatif étiage, comme le Haut Moyen Âge ou la période 1920-1950. Encore faut-il s’entendre sur le terme même de « poésie scientifique ». Il est possible de distinguer la poésie à caractère didactique, qui reproduit de façon lyrique et avec plus ou moins de bonheur la parole du scientifique, et une sorte de poésie philosophique ou cognitive, certes inspirée par la science, mais qui prend des formes littéraires plus inventives. La première donne un juste et intéressant reflet de l’intégration des connaissances scientifiques dans la culture à une époque donnée. La seconde veut être la représentation la plus étendue et la plus intense de «cette réalité constamment vivante, constamment changeante, aux diverses parties liées intimement et qui se pénètrent mutuellement» (Henri Poincaré).
Une partie de l’œuvre poétique de Charles Dobzynski me semble relever de ces deux genres : outre son Opéra de l’espace déjà cité, ses recueils Table des éléments (Belfond, 1978) et Délogiques (1981) en témoignent. A ce titre, il appartient pleinement à la famille de ceux que j’ai appelés ailleurs les « rêveurs d’univers » – ceux qui, à l’instar de Jean Paul Richter, savent voir au-delà du décor et, ce faisant, réinventent le monde. Le rêveur d’univers en effet, riche de son acquis en tous les domaines du savoir, riche aussi de ses lacunes et de ses doutes, de son intuition étrangement divinatrice, se crée une compréhension équilibrée et synthétique du monde. Il repense les matériaux objectifs que lui apportent les sciences et les complète d’intuition, il en trouve les secrètes résonances unitaires. Les abîmes de grandeur et de petitesse que dévoilent le télescope et le microscope, l’harmonie cachée des lois naturelles, la vie renaissante et diverse sont des thèmes dignes de l’inspirer. Jadis il a rêvé sur l’attraction universelle, la nébuleuse primitive ou la mort froide des mondes; aujourd’hui la mécanique quantique, le big bang, les trous noirs, la conquête spatiale lui ouvrent de nouveaux champs poétiques.
C’est ainsi que dans l’un des textes d’Opéra de l’Espace intitulé « La dernière galaxie », Charles Dobzynski décrit dans un lyrisme puissant et avec une grande justesse scientifique comment la fuite générale des galaxies et le rougissement de leur spectre traduisent la réalité observationnelle de l’expansion cosmique :
La galaxie en fuite, goutte folle,
trop-plein de feu dont le vide déborde,
tombe parfois dans un autre univers.
Ivre de sa vitesse elle dévide
tout l’écheveau de la lumière et casse
l’ultime fil qui la retient à nous.
Elle franchit, dans le spectre visible,
la limite du rouge; elle se noue
pour mieux bondir dans la dimension
qui s’ouvre au-delà de la connaissance.
Un seul déclic d’espace, un clapotis
de clarté diffuse au large des âges
marque sa mort et sa métamorphose.
La galaxie en fuite à la fraieson
est une truite arc-en-ciel qui remonte
le cours du temps vers de plus basses eaux,
vers des retraits obscurs de la durée.
Le frai commence et c’est un flamboiement
d’astres couvrant l’ombre de leurs écailles.
Et le temps tombe ainsi qu’une laitance.
Ayant peuplé le vide d’alevins
et d’un levain d’aurores inouïes
la galaxie revient à son rivage,
mais à jamais son rivage la fuit.
Errant dès lors en un pays mental
– le no man’s land de l’être et du non-être –
la galaxie en exil sur un plan
plus secret de l’ombre et de la lumière,
nous traverse peut-être avec ses feux,
ses soleils fous et ses vrilles de vie,
abandonnant parfois dans nos sillons
à son passage un grain de sa mémoire.
Autre thème fort d’inspiration pour les poètes scientifiques de la seconde moitié du XXe siècle, les modèles d’évolution des étoiles qui se sont développés avec succès à partir des années 1930, dès lors que leur source d’énergie interne – l’énergie nucléaire – était identifiée. Les apocalypses stellaires, d’abord imaginées par les théories astrophysiques puis confirmées par l’observation télescopique, engendrent morts et renaissances. À la fin de leur vie de lumière, les étoiles massives expulsent violemment leurs couches externes, tandis que leur cœur s’effondre sur lui-même. C’est le phénomène de la supernova. Les débris gazeux de l’explosion ensemencent en « atomes lourds » les espaces interstellaires, engendrant de proche en proche de nouvelles naissances stellaires qui accueillent en leur sein les ferments d’étoiles disparues. C’est le célèbre « Patience ! Patience dans l’azur, chaque atome de silence est la chance d’un fruit mûr ! » de Paul Valéry, titre repris par un ouvrage de vulgarisation connu de tous. Cette belle image du bûcher fécond est retenue par Charles Dobzynski dans son poème « Supernova » :
Un tremblement d’éther. Une fissure
d’où gicle un faisceau d’ions et de flammes
noués par la racine et la rosace.
Salves – scories de bruits et de couleurs
énucléées – collisions d’aurores.
Grappe de foudre. Et l’onde concentrique
des vibrations sur la vitre d’un rêve.
Caillots d’échos coagulant un quartz,
et la nuit fond d’un bloc. Et sa banquise
forme un bourbier d’étoiles sous la pluie
chaude-chantante : une pluie-en-la-chair,
un suintement sans fin de soleil mort,
une agonie de bouche où l’or bouillonne.
L’explosion d’un grisou dans l’aorte
de la matière en son amas natal.
Sang trop compact, tumeur de l’énergie
qui fait fumer une fièvre d’atomes.
Est-ce la pluie qui tombe ou le grésil
de la lumière aride? Est-ce la pluie
ou bien les stries de la mort dans le spectre?
Est-ce une pluie de pierres pyrogènes,
ou bien le bris d’une étoile en éclats
comme un miroir de mille et mille vies
où notre image ancienne se détruit
puis nous revient, par les années-lumière,
neiger en nous pour une autre naissance?
 Je mentionnerai encore, parmi tant d’autres que Dobzynski a abordés, le thème du voyage cosmique. C’est un genre littéraire en soi, dont le succès témoigne de ses racines profondes dans la sensibilité. Le mythe d’Icare rappelle combien l’homme a toujours rêvé de s’affranchir de la pesanteur et de conquérir l’espace. L’histoire de la littérature est jalonnée de textes brillants rattachés au thème du voyage cosmique, de Cicéron à Cendrars en passant par Dante, L’Arioste ou Cyrano de Bergerac. Mais qu’en est-il de sa version moderne, à savoir le voyage astronautique, né le jour où la présence de l’homme dans l’espace n’a plus relevé du rêve mais est devenue effective ? La conquête spatiale, commencée à la fin des années 1950 avec le lancement des premiers Spoutniks, a été avec l’informatique l’achèvement scientifique, technologique et culturel le plus marquant de la seconde moitié du XXe siècle. On s’est légitimement demandé si l’imaginaire cosmique des poètes allait être stérilisé dès lors que l’espèce humaine aurait de facto réalisé son rêve de voler dans l’espace. Prenons le cas de la Lune. Est-elle démodée en poésie ? Claude Roy l’a affirmé dans un charmant petit poème de 1993. Il est vrai que l’exploit d’Apollo XI en 1969 a passionné les savants mais consterné certains poètes. Souillée par le premier pas de l’homme, la Lune ne serait plus une terre de rêves, mais un tas de pierres piétiné par quelques Américains.
Je mentionnerai encore, parmi tant d’autres que Dobzynski a abordés, le thème du voyage cosmique. C’est un genre littéraire en soi, dont le succès témoigne de ses racines profondes dans la sensibilité. Le mythe d’Icare rappelle combien l’homme a toujours rêvé de s’affranchir de la pesanteur et de conquérir l’espace. L’histoire de la littérature est jalonnée de textes brillants rattachés au thème du voyage cosmique, de Cicéron à Cendrars en passant par Dante, L’Arioste ou Cyrano de Bergerac. Mais qu’en est-il de sa version moderne, à savoir le voyage astronautique, né le jour où la présence de l’homme dans l’espace n’a plus relevé du rêve mais est devenue effective ? La conquête spatiale, commencée à la fin des années 1950 avec le lancement des premiers Spoutniks, a été avec l’informatique l’achèvement scientifique, technologique et culturel le plus marquant de la seconde moitié du XXe siècle. On s’est légitimement demandé si l’imaginaire cosmique des poètes allait être stérilisé dès lors que l’espèce humaine aurait de facto réalisé son rêve de voler dans l’espace. Prenons le cas de la Lune. Est-elle démodée en poésie ? Claude Roy l’a affirmé dans un charmant petit poème de 1993. Il est vrai que l’exploit d’Apollo XI en 1969 a passionné les savants mais consterné certains poètes. Souillée par le premier pas de l’homme, la Lune ne serait plus une terre de rêves, mais un tas de pierres piétiné par quelques Américains.
Toute autre est l’interprétation de Charles Dobzynski. Dès l’envol des premiers cosmonautes russes en 1961, il a entrevu combien l’âge interplanétaire allait ouvrir de nouvelles formes du rêve. A priori, rien n’est plus éloigné de la poésie que la technologie de pointe. Mais le véritable poète sait puiser dans tous les domaines de l’inventivité humaine, et Dobzynski le démontre avec un texte magistral (toujours extrait d’Opéra de l’Espace) consacré au décollage d’une fusée, dans lequel il réussit à concilier la haute poésie et la technique des propulseurs. Avec lui le vide spatial se fait chair, ventre, dans lequel l’astronef-graine fondera le futur.
Puissance de l’air lourd, musculature du métal dans le faisceau de la fusée attelée à la foudre, à l’araire des vents,
et trouant le tissu compact de l’étendue, l’opacité qui se contracte et sa déchirure s’étend
ramification d’éclats et d’explosions dans l’épiderme atmosphérique,
avez-vous entendu la stridence de l’astronef striant ce que l’on nommait dérisoirement
l’éther ? une immensité vivante et mouvante, un ondoiement noir
où lentement la vie s’accroît et s’agglomère, spectrographie de tous les rêves, précipité de la mémoire,
oisellerie de flammes, l’astronef, nouant une aube boréale en la ceinture Van Allen
et l’air se fend comme une orange, et dans la trame qu’il défait,
ne laissant à sa foulure bleue ni trace de trépan ni fragment d’horizon foudroyé,
l’astronef s’enfonce dans l’infini avec cet abandon tranquille du dormeur ou du noyé,
le vide est chair et changement, chair élastique et conductible songe proliférant dans l’obscurité d’un seul corps,
et dans ce ventre sans parois l’astronef fonde le futur,
le futur à peine une graine, une pulsation de pollen planétaire,
et quel vent d’outre-monde emporte au gré des ondes la promesse
de toutes les germinations? le prélude incandescent à la parturition terrestre
et quel vent se gonfle soudain de toute la tendresse des âges?
Voici le passage du cyclone et l’éclosion du cyclamen de l’aube,
pareille à l’éclat violet de la lampe à arc, voici la flamboyante trajectoire
de l’été, le caméléon de l’été fou, le camée qui prend feu entre deux feuilles de la nuit prémonitoire.
Dans cette mère du cosmos, indifférente à ce qui s’établit, mouvante en ses mucosités, tout occupée à nourrir son sommeil éternellement,
Voici l’astronef roulant le feu de sa torsade et la vitesse est son enfantement,
clarté dans l’ombre, éclair dans la fumée,
Chair dans la chair et chaleur dans la glace : une vie au-delà du néant va germer.
Je concluerai par ces mots extraits d’un courrier que Charles Dobzynski m’a adressé en septembre 2011, qui ne sauraient mieux résumer sa certitude de poète face aux incertaines avancées de la science : « La sphère du doute s’est étendue, en même temps que celle de l’espoir. Tandis que notre planète est menacée, on entrevoit des essaims d’exo-planètes où, qui sait, la vie est apparue ou apparaîtra, brisant notre solitude galactique. […]. La poésie invente ce que l’œil ne peut encore entrevoir. »
[1] Publiée en 1996 aux éditions du Cherche Midi sous le titre Les poètes et l’Univers.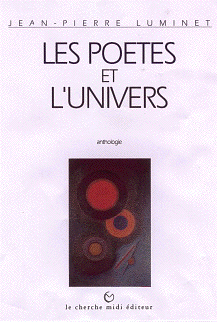



Malgré l’heure tardive, je me laisse embarquer dans le cosmos de la poésie de Charles Dobznski… Un regard sur l’intimité entre l’être et l’univers, passion d’éternité…
Je viens d’éditer mon premier livre de poésie sur le même thème.
Je vais lire “Les poètes et l’Univers” Merci à vous pour vos travaux en astrophysique et leurs vulgarisations.
J’ai connu une dame Luminet qui venait en vacances au Chatelard en Bauges.
Cordialement, Annie Leclerc
Moi aussi , je rêve des horizons à la verticale ! Merci aux
poetes astronautiques qui nous emmenent dans leur cargo
de beaute transcendante ! ! ! 🙂
Bonjour,
Savez-vous si Charles Dobzynski est l’auteur du poème “Le ciel et la ville” que certains sites web attribuent à un certain Claude Bobzynski?
Je ne trouve aucune source afin de le confirmer ou de l’infirmer.
D’avance merci
Bonjour, Charles Dobzynski est bien l’auteur du poème, Claude Bobzynski est une altération du net…